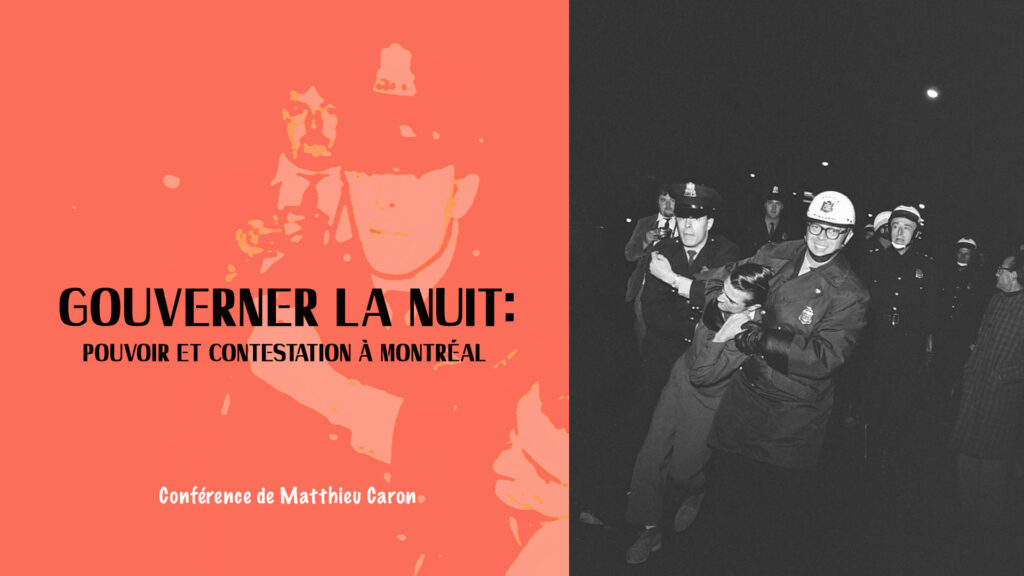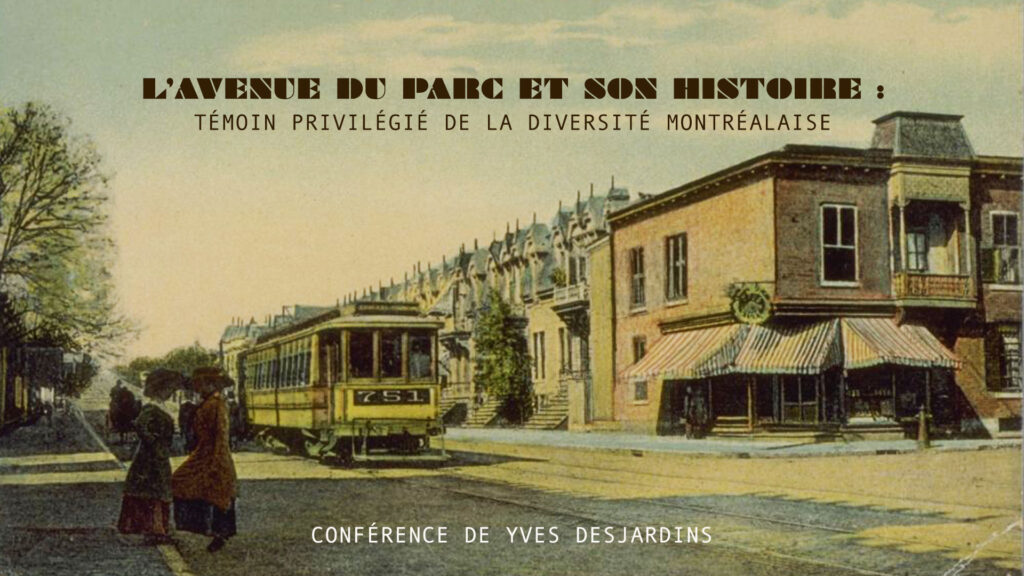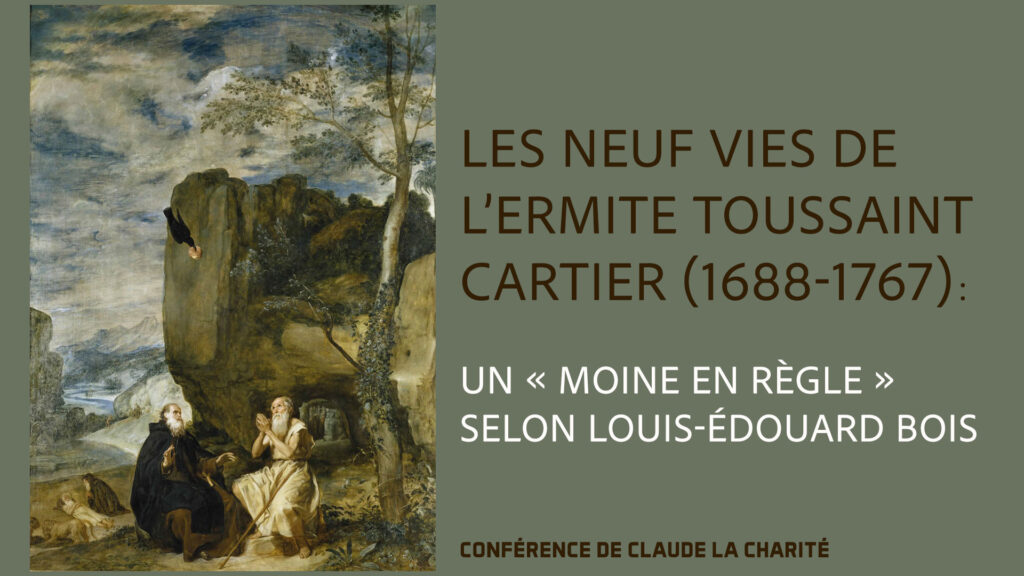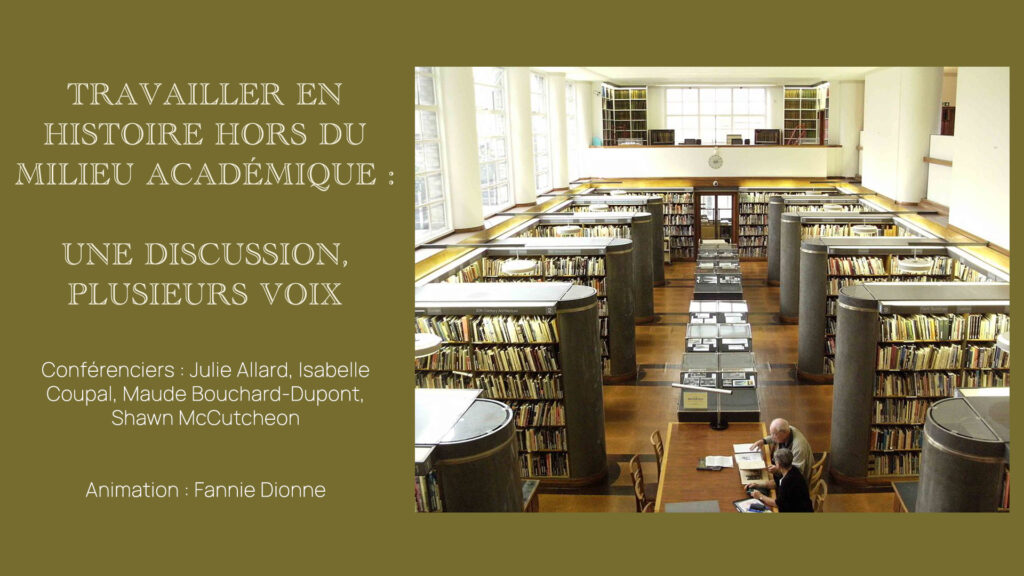
Quel avenir pour les étudiant.e.s du milieu de l’histoire? Une discussion avec Julie Allard, Isabelle Coupal, Maude Bouchard-Dupont et Shawn McCutcheon. Animation par Fannie Dionne.
Quoi faire avec un diplôme dans le domaine de l’histoire alors que les postes universitaires sont très rares et que tous les étudiant.e.s ne veulent pas nécessairement se diriger vers ce type d’emploi ?
Cette discussion rassemble des professionnel.le.s l’histoire, de la médiation patrimoniale et de l’archéologie, afin de dresser un portrait concret des débouchés possibles et des défis du marché de l’emploi.
L’objectif ? Permettre aux étudiant.e.s d’avoir plusieurs points de vue et de poser des questions à des intervenant.e.s qui ont un parcours diversifié.
Avec:
- Julie Allard, Cofondatrice de l’Usine à histoire(s)
- Isabelle Coupal, Archéologue conservatrice
- Maude Bouchard-Dupont, Consultante en histoire appliquée
- Shawn McCutcheon, Éditeur, chercheur et historien consultant
Une conférence présentée par la SHM en partenariat avec le musée Pointe-à-Callière.
Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Samedi 11 octobre 2025 à 14h (entrée gratuite pour les membres de la SHM, 5$ pour les non-membres)
Fiche pratique
Salle Kondiaronk, mezzanine du pavillon principal (ancienne salle polyvalente)
350, place Royale
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5